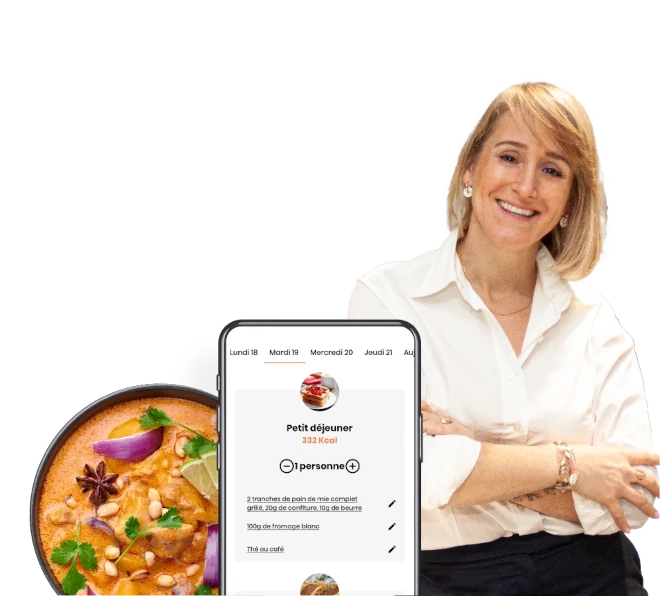« Syndrome du poisson pourri » : la maladie invisible qui détruit des vies
Par Léo Martinet
Publié le - mis à jour le

Sommaire
On imagine souvent que les mauvaises odeurs corporelles sont liées à une mauvaise hygiène, à l’alimentation ou à un simple déséquilibre hormonal. Mais pour certaines personnes, cette odeur persistante et nauséabonde n’a rien à voir avec cela : elle est le symptôme d’une maladie métabolique rare, longtemps ignorée et encore largement méconnue du grand public — la triméthylaminurie, plus connue sous le nom de « syndrome du poisson pourri ». Derrière son appellation presque caricaturale se cache une réalité médicale et psychologique d’une extrême violence.
Une maladie rare mais bien réelle
Le syndrome du poisson pourri est une affection métabolique rare dans laquelle le corps est incapable d’éliminer correctement une molécule odorante : la triméthylamine (TMA).
Cette substance est naturellement produite lors de la digestion d’aliments riches en choline, un nutriment présent notamment dans :
les poissons et fruits de mer,
les œufs,
le foie,
les légumineuses (fèves, pois, soja),
ou encore certains légumes verts.
Chez la plupart des gens, cette molécule est transformée par le foie grâce à une enzyme (la FMO3) en un composé inodore, la triméthylamine N-oxyde.
Mais chez les personnes atteintes de triméthylaminurie, cette transformation ne se fait pas correctement. Résultat : la TMA s’accumule dans le corps et s’évacue par la sueur, l’urine, la salive et même la respiration, provoquant une odeur forte de poisson avarié.
Des origines génétiques… mais pas seulement
La forme la plus courante du syndrome du poisson pourri est génétique.
Elle est due à une mutation du gène FMO3, qui code l’enzyme censée neutraliser la triméthylamine. La maladie peut apparaître dès la naissance ou à l’adolescence, souvent à la suite d’un dérèglement hormonal.
Mais il existe aussi des formes acquises :
à la suite d’une insuffisance hépatique,
après certains traitements médicamenteux,
ou lors de déséquilibres hormonaux, par exemple pendant la grossesse ou la ménopause.
Autrement dit, ce syndrome n’est pas toujours héréditaire : il peut survenir de manière temporaire chez certaines personnes, avant de disparaître lorsque la cause sous-jacente est traitée.
Un diagnostic souvent retardé, voire manqué
La triméthylaminurie reste largement sous-diagnostiquée.
D’abord parce qu’elle est rare, mais surtout parce que ses symptômes sont déroutants : une simple odeur corporelle n’évoque pas spontanément une maladie métabolique.
Nombre de patients passent des années dans l’incompréhension, oscillant entre honte, isolement et errance médicale.
Beaucoup racontent le même parcours : changement répété de savon, de déodorant, de lessive, de régime alimentaire… sans aucun résultat. Les médecins, faute de connaître cette pathologie, évoquent souvent le stress, la transpiration excessive ou un trouble psychologique.
Certains patients finissent par éviter les transports en commun, le travail en équipe ou les lieux publics, de peur d’être jugés.
Une étude parue dans La Revue de médecine interne cite le témoignage de deux femmes : l’une a attendu 20 ans avant d’obtenir un diagnostic, l’autre a vécu toute sa vie avec cette odeur sans explication médicale.
Un test simple pour confirmer la maladie
Heureusement, il existe aujourd’hui un test de dépistage fiable et rapide.
Il consiste à mesurer la quantité de triméthylamine présente dans les urines après ingestion d’un aliment riche en choline.
Si le taux est élevé, une analyse génétique permet de confirmer la présence d’une mutation du gène FMO3.
Ce test, pourtant simple à réaliser, reste encore trop peu prescrit. Les associations de patients militent pour qu’il soit mieux connu des médecins généralistes et des dermatologues, afin d’éviter des années de souffrance inutiles.
Des traitements qui soulagent sans guérir
Il n’existe pas encore de traitement curatif, mais plusieurs mesures permettent de réduire considérablement les symptômes :
1. Adapter son alimentation
Limiter les aliments riches en choline, lécithine ou carnitine, c’est-à-dire :
poissons, crustacés,
abats, foie, œufs,
légumineuses (fèves, pois chiches, soja),
cacahuètes et certaines graines.
Cette adaptation ne supprime pas la maladie, mais diminue la production de triméthylamine par l’organisme.
2. Prendre des compléments spécifiques
La riboflavine (vitamine B2) aide à améliorer le fonctionnement enzymatique et peut réduire la concentration de TMA dans le corps.
Dans certains cas, des antibiotiques à faible dose (comme la néomycine ou la métronidazole) sont prescrits pour modifier la flore intestinale et freiner la production de la molécule odorante.
3. Hygiène et soins adaptés
L’utilisation de savons légèrement acides (pH 5,5 à 6,5), d’huiles essentielles douces comme le géranium ou la lavande, et le changement régulier de vêtements peuvent aider à limiter l’odeur.
Mais ces gestes ne sont qu’un complément : le problème vient de l’intérieur, pas de la peau.
4. Soutien psychologique
La détresse psychique liée à cette maladie est immense.
Les personnes atteintes développent souvent de l’anxiété sociale, une faible estime d’elles-mêmes, voire des symptômes dépressifs.
Un accompagnement psychologique ou un groupe de parole peut être crucial pour retrouver confiance et rompre l’isolement.
Une maladie qui interroge la société
Au-delà de l’aspect médical, le syndrome du poisson pourri met en lumière un tabou encore fort autour du corps et des odeurs naturelles.
Les patients subissent un double fardeau : la gêne physique et le regard des autres.
Cette affection, invisible à première vue, illustre parfaitement comment une maladie rare peut avoir des conséquences sociales et émotionnelles dévastatrices.
Reconnaître la triméthylaminurie comme une maladie à part entière, c’est rendre leur dignité à celles et ceux qui en souffrent, et rappeler que certaines odeurs ne relèvent pas d’un manque d’hygiène, mais d’un déséquilibre biologique indépendant de la volonté.
Une odeur qui en dit long
Le « syndrome du poisson pourri » n’est pas une curiosité médicale, mais une réalité biologique et humaine.
Grâce à une meilleure information du public et des professionnels de santé, il devient aujourd’hui possible de poser un diagnostic et d’apporter des solutions concrètes à des personnes souvent désespérées.
Une odeur anormale et persistante doit donc être prise au sérieux, au même titre qu’une douleur ou qu’un symptôme visible.
Car derrière cette odeur se cache parfois une vie entière d’exclusion, qu’un simple test pourrait transformer en un retour à la normalité.
Le syndrome du poisson pourri (triméthylaminurie) est une maladie métabolique rare liée à une accumulation de triméthylamine.
Elle provoque une odeur persistante de poisson, indépendante de l’hygiène.
Un test urinaire et une analyse génétique permettent le diagnostic.
Une alimentation adaptée et un suivi médical peuvent considérablement améliorer la qualité de vie.
Un message essentiel : une odeur peut être un symptôme. La reconnaître, c’est déjà soigner.
Donnez-nous votre avis !
Envoyer mon avisMerci pour votre retour.