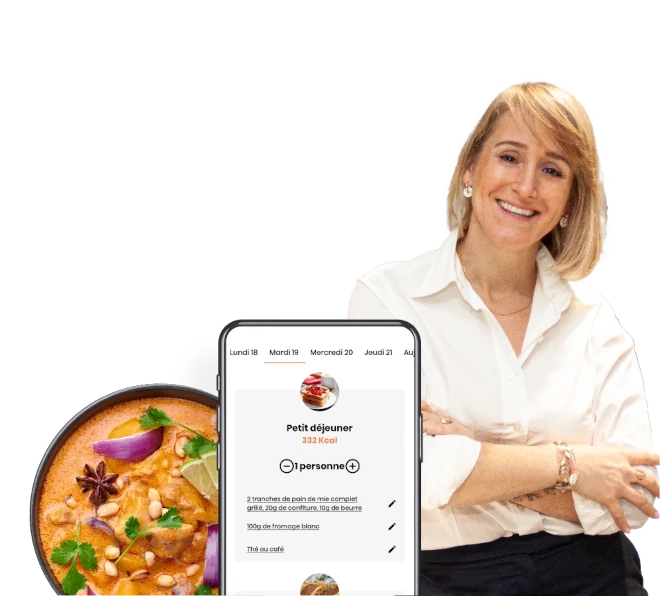Quelles sont les conséquences d'un excès de sodium ?
Par Béatrice Langevin
Publié le - mis à jour le

Un excès de sodium peut avoir de vraies conséquences sur la santé : hypertension, rétention d’eau, fatigue rénale... Découvrez comment mieux le repérer et l’équilibrer dans votre alimentation.
Le sodium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Il joue un rôle clé dans l’équilibre hydrique, la transmission nerveuse et la contraction musculaire, y compris celle du cœur. On en trouve principalement dans le sel de table (chlorure de sodium), mais aussi, et surtout, dans une large gamme de produits transformés.
Si le sodium est vital en quantité raisonnable, sa consommation excessive est aujourd’hui un problème courant, souvent invisible, car liée à des habitudes alimentaires industrielles.
Or, un excès chronique peut avoir des conséquences notables sur la santé, parfois silencieuses au début, mais lourdes à long terme.
Apport recommandé en sodium : où est le juste équilibre ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de ne pas dépasser 2 g de sodium par jour, soit environ 5 g de sel. En France, la consommation moyenne dépasse largement cette valeur, avec environ 8 à 10 g de sel par jour selon les dernières études.
Cela s’explique par la présence massive de sel dans les produits transformés : charcuterie, plats préparés, soupes industrielles, fromages, sauces, pains, snacks salés… L’essentiel du sodium que nous consommons ne vient pas du sel ajouté à table, mais de celui déjà présent dans nos aliments.
Conséquence n°1 : une pression artérielle en hausse
L’effet le plus connu de l’excès de sodium est son impact sur la pression artérielle. Le sodium retient l’eau dans l’organisme. Plus il y en a, plus le volume de sang augmente… ce qui augmente la pression exercée sur les parois des artères.
Un apport chronique trop élevé peut donc favoriser :
Une hypertension artérielle, parfois silencieuse
Un vieillissement accéléré des artères
Une surcharge de travail pour le cœur
L’hypertension est elle-même un facteur de risque majeur d’accidents cardiovasculaires, d’insuffisance rénale ou d’AVC.
Conséquence n°2 : un déséquilibre hydrique et une rétention d’eau
Le sodium attire l’eau : c’est un fait biologique. Lorsque l’on en consomme trop, le corps a tendance à retenir les liquides, ce qui peut provoquer une sensation de gonflement, notamment au niveau des :
chevilles
doigts
visage
Ce phénomène est encore plus marqué chez les personnes sensibles au sel, en cas de sédentarité ou lors de déséquilibres hormonaux (syndrome prémenstruel par exemple).
Conséquence n°3 : une charge rénale accrue
Les reins sont les organes chargés d’éliminer l’excès de sodium par l’urine. Lorsque l’apport est trop élevé, ils doivent travailler davantage, ce qui, sur le long terme, peut :
Accélérer l’usure du tissu rénal
Favoriser la déshydratation intracellulaire
Augmenter le risque de calculs rénaux ou de pathologies rénales chroniques, surtout en cas de prédisposition
Chez les personnes déjà atteintes de troubles rénaux, une réduction stricte de l’apport en sodium est indispensable.
Conséquence n°4 : un effet indirect sur le poids et la digestion
Bien que le sel n’apporte aucune calorie, un excès de sodium peut :
Augmenter l’appétence pour les aliments gras et transformés
Favoriser une surconsommation globale, notamment dans les snacks et produits salés industriels
Masquer la saveur naturelle des aliments, ce qui rend plus difficile la transition vers une alimentation plus brute
Par ailleurs, une alimentation trop salée peut aussi perturber la flore intestinale, ce qui influence indirectement la digestion, l’inflammation et le métabolisme.
Conséquence n°5 : des effets sur les os et la densité minérale
Un excès chronique de sodium favorise l'élimination du calcium par les urines, ce qui peut fragiliser progressivement la densité osseuse. Cela est particulièrement problématique chez :
Les femmes ménopausées
Les personnes âgées
Les personnes ayant une alimentation déjà pauvre en calcium
👉 Un apport excessif en sel, combiné à une carence en produits frais riches en calcium (laitages, légumes verts, amandes, sardines…), peut favoriser l’ostéoporose sur le long terme.
Comment réduire son apport en sodium au quotidien ?
Le but n’est pas de bannir le sel, mais de reprendre le contrôle sur sa consommation en privilégiant une alimentation plus naturelle et moins transformée.
Voici quelques gestes simples :
Privilégier le fait maison dès que possible
Goûter avant de saler et réduire progressivement la quantité ajoutée
Lire les étiquettes et repérer les produits très salés (plus de 1,5 g de sel pour 100 g)
Utiliser des alternatives aromatiques : herbes fraîches, épices, citron, vinaigre, ail, oignon
Éviter les sauces industrielles (soja, ketchup, moutarde, cubes de bouillon...)
Dans l’approche CROQ, le sel est un outil de saveur, pas un automatisme : utilisé avec justesse, il met en valeur les aliments sans nuire à l’équilibre.
Une vigilance nécessaire… sans tomber dans l’excès inverse
Le sodium reste un minéral essentiel, et un apport trop faible peut aussi être problématique (fatigue, crampes, hyponatrémie chez les sportifs, etc.). Mais dans le contexte alimentaire occidental, le vrai défi est plutôt la surconsommation chronique, souvent silencieuse, mais aux effets cumulatifs.
Mieux vaut donc viser une modération intelligente, en adoptant des habitudes durables plutôt qu’une privation stricte. Le goût s’éduque, et il est tout à fait possible de retrouver le plaisir des aliments peu salés, à condition de les associer à des textures, des couleurs, et des saveurs équilibrées.
Donnez-nous votre avis !
Envoyer mon avisMerci pour votre retour.