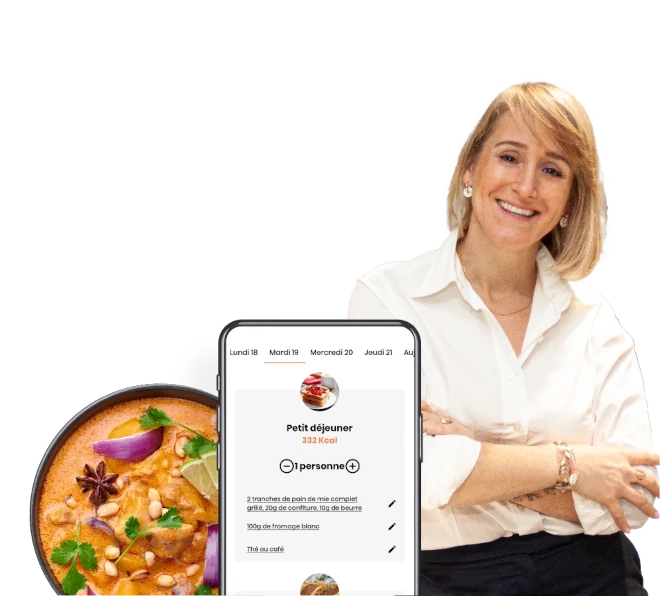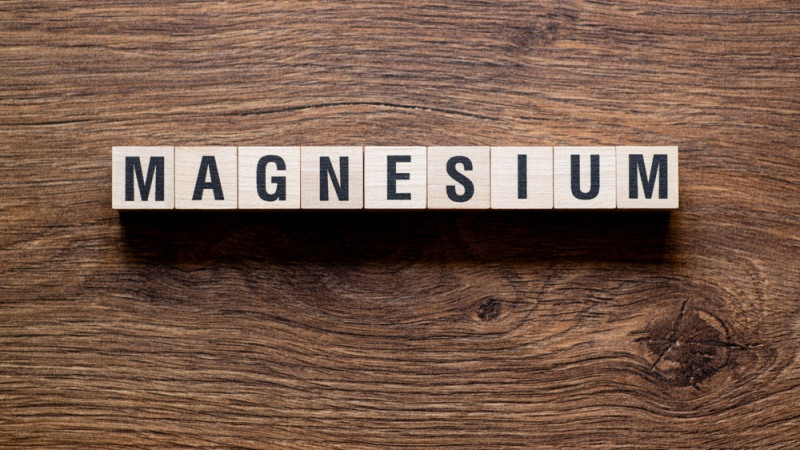Pourquoi faut-il arrêter de diaboliser certains aliments ?
Par Léa Garneau
Publié le - mis à jour le

Diaboliser certains aliments — les qualifier de “mauvais”, de “toxiques”, de “interdits” — est un réflexe courant dans nos pratiques alimentaires. Pizza, chocolat, féculents, graisses, sucreries : tous peuvent tour à tour incarner “le vilain aliment”. Mais ce réflexe, bien que souvent issu d’une bonne intention, comporte de sérieux inconvénients. Nous allons voir pourquoi cette approche est problématique, quels effets elle produit sur notre rapport à l’alimentation, et comment adopter une vision plus saine, plus souple et plus durable de ce que nous mangeons.
La genèse de la diabolisation alimentaire
Pourquoi certains aliments sont‑ils si souvent présentés comme “à éviter à tout prix” ? Plusieurs facteurs convergent : les médias simplifient les messages nutritionnels (“les glucides font grossir”, “les graisses sont mauvaises”), l’industrie alimentaire met en avant “light”, “sans sucre”, “zéro graisses”, ce qui donne à certaines versions une image d’aliment vertueux. De plus, les régimes restrictifs font souvent de certains aliments la cause du problème (et donc leur élimination la solution). Ce discours s’installe dans la culture quotidienne, au point que nous finissons par considérer qu’il existe des aliments “bons” et “mauvais” : une vision « tout ou rien ».
Les effets néfastes de ce regard « bon / mauvais »
La diabolisation génère plusieurs conséquences indésirables.
D’abord, elle alimente la culpabilité et la honte : lorsque l’on consomme cet “aliment interdit”, on se sent coupable, on “déraille”, on compense ou on se restreint davantage. Cela peut rendre l’alimentation stressante.
Ensuite, elle crée un effet de privation qui encourage les fringales, les excès et les comportements alimentaires en cycle (restriction → restriction rompue → culpabilité → restriction). Une approche punitive ne favorise pas la modération durable mais l’oscillation.
Elle empêche de voir l’aliment dans son contexte global : un aliment n’est pas uniquement défini par un nutriment ou un ingrédient, mais par la fréquence, la quantité, l’équilibre global du repas, l’accompagnement, l’intention. En le qualifiant “mauvais”, on oublie cette nuance.
Elle peut nuire à la relation à soi, loin de l’écoute, de la liberté, de la détente : manger devient une source d’anxiété ou de jugement plutôt qu’un plaisir nourrissant.
Pourquoi cette diabolisation repose sur des simplifications excessives
Quand on observe ce qu’impliquent vraiment les aliments, on comprend que la classification simple “bon / mauvais” ne tient pas.
Parce qu’un même aliment peut être modifié ou non : un pain complet simple n’est pas le même qu’un pain industriel ultra‑transformé.
Parce que c’est l’ensemble de l’alimentation (le moment, la portion, la composition) qui fait la différence, plus que l’aliment isolé.
Parce que la notion de besoin individuel varie : âge, activité, métabolisme, préférences, situation de santé. Un aliment “diabolisé” pour une personne peut être parfaitement intégré par une autre dans une alimentation équilibrée.
Ainsi, diaboliser revient souvent à ignorer ces facteurs modulants, à réduire l’aliment à un seul critère caricatural.
Les avantages d’une approche plus souple et bienveillante
Adopter une posture d’acceptation raisonnée plutôt que de condamnation permet plusieurs bénéfices.
Vous libérez votre alimentation de la culpabilité : consommer un aliment plaisir ne devient pas un “écart” mais un moment normal, intégré.
Vous favorisez la modération plutôt que l’excès : quand rien n’est “interdit”, rien n’est incontrôlé ou clandestin. Vous pouvez manger avec conscience, selon le désir et le besoin.
Vous redonnez à l’aliment une dimension positive : plaisir, convivialité, partage, diversité nutritionnelle. Cela nourrit aussi l’équilibre psychologique.
Vous développez une relation durable à l’alimentation : l’objectif n’est plus “résister” à l’aliment mauvaise réputation, mais intégrer tous les aliments dans une vision globale, cohérente et respectueuse de votre corps.
Comment passer de la diabolisation à l’intégration intelligente ?
Voici des pistes concrètes à adopter.
Changez le vocabulaire : remplacez “interdit”, “mauvais” par “à consommer avec modération”, “à savourer à l’occasion”.
Adoptez une logique de fréquence et portions : cet aliment n’est pas éliminé, mais introduit à un rythme qui convient à votre vie, à votre corps, à votre situation.
Évaluez l’ensemble du repas : un burger occasionnel dans une journée riche en légumes n’a pas le même impact qu’une journée déséquilibrée.
Pensez à l’intention : êtes‑vous en train de manger par plaisir, par faim, par émotions ? Quand l’aliment est choisi consciemment, il devient un acte positif.
Travailler sur la flexibilité alimentaire : acceptez que l’alimentation soit variée, que certains jours soient moins « parfaits » que d’autres, que l’équilibre se fasse sur la semaine plus que sur chaque repas.
Et surtout, cultivez une écoute de votre corps : comment vous sentez‑vous après avoir mangé cet aliment, dans quelle quantité, dans quel contexte ? Cette mise en conscience vaut plus que la simple liste “bon/mauvais”.
Les limites à garder en tête
Ce message ne nie pas que certains aliments ou pratiques alimentaires peuvent poser problème (ultra‑transformés, excès de sucres, graisses saturées, additifs). Il ne s’agit pas de tout autoriser sans réflexion. Mais plutôt de reconnaître que la diabolisation généralisée n’est pas la solution. De plus, en cas de pathologie spécifique (diabète, allergies, intolérances), certaines recommandations restent nécessaires. Enfin, remettre l’aliment sur la table ne ramène pas automatiquement à l’équilibre : l’intention, la fréquence, le contexte et l’accompagnement sont essentiels.
Arrêter de diaboliser certains aliments, ce n’est pas faire n’importe quoi. C’est remettre l’aliment à sa juste place : ni héros absolu, ni ennemi déclaré. C’est choisir la nuance, l’écoute, le contexte. En adoptant cette démarche, vous construisez une relation à l’alimentation plus sereine, plus équilibrée, plus durable. Vous ne nourrissez plus seulement votre corps, mais aussi votre liberté, votre plaisir et votre bien‑être. Et c’est peut‑être là toute la différence.
Donnez-nous votre avis !
Envoyer mon avisMerci pour votre retour.