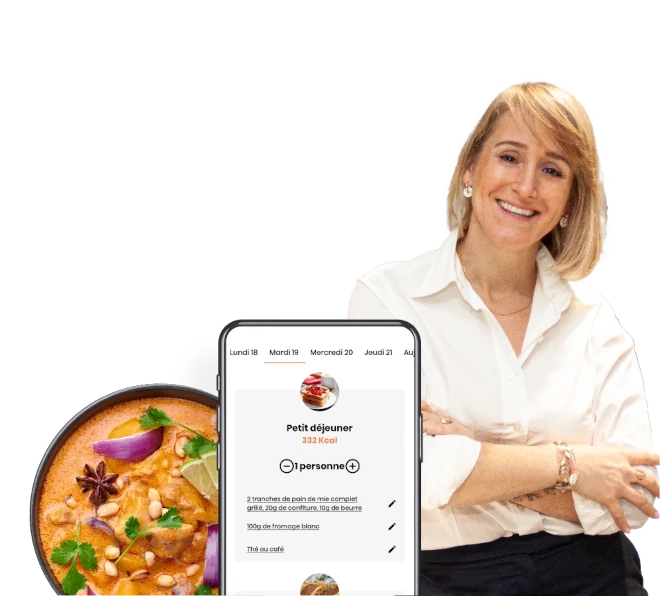Crier : c’est bon pour la santé ?
Par Catherine Duchamps
Publié le - mis à jour le

Sommaire
Crier, c’est instinctif. Que ce soit de colère, de joie, de douleur ou de soulagement, un cri peut jaillir sans prévenir. Mais ce geste vocal apparemment simple cache une réalité bien plus complexe. Est-ce que crier nous fait vraiment du bien ? Quels effets sur notre corps, notre esprit, nos relations ? Plongeons ensemble dans les bienfaits – et les limites – de cette expression si humaine.
Un exutoire émotionnel naturel
Lorsque nous crions, nous libérons des tensions enfouies. La colère, la frustration ou l’angoisse s’accumulent en silence… jusqu’à ce qu’un cri vienne tout relâcher. C’est une véritable soupape. Cette décharge émotionnelle stimule la production d’adrénaline et de noradrénaline, deux hormones du stress. Mais paradoxalement, une fois le cri passé, le niveau de stress diminue. On ressent souvent une forme de calme, de soulagement, presque comme après avoir pleuré.
Crier, dans un contexte maîtrisé, permet donc de clarifier l’esprit et relâcher la pression. C’est une manière simple et puissante de ne pas garder tout à l’intérieur.
Un impact réel sur le corps
Crier sollicite fortement la respiration, les muscles abdominaux, les poumons, le diaphragme, mais aussi le visage, la gorge et le haut du dos. C’est une action physique à part entière ! Ce mouvement intense favorise la circulation sanguine, augmente l’oxygénation et peut même donner un coup de boost énergétique, comme après une séance de sport rapide.
Cependant, si le cri est trop fréquent ou mal géré, il peut provoquer une fatigue vocale, voire des lésions des cordes vocales. L’enrouement, la voix cassée ou la gorge douloureuse sont des signes qu’il est temps de faire une pause. Dans les cas extrêmes, on peut même observer l’apparition de nodules vocaux.
Le pouvoir du cri partagé
Crier n’est pas toujours un acte solitaire. On crie aussi en groupe, dans un stade, pendant un concert, au sommet d’une montagne ou lors d’un accouchement. Ces cris partagés ont une force particulière : ils renforcent la cohésion, le sentiment d’appartenance, l’intensité d’un moment vécu ensemble.
Dans le sport, par exemple, un cri collectif peut motiver, créer une dynamique de groupe, marquer un but symbolique ou une victoire émotionnelle. Dans la nature, crier fort peut donner une sensation de puissance et de liberté, comme si on reprenait possession de son espace.
Crier peut aussi être un signal dans une relation : dire stop, manifester une limite ou appeler à l’aide. Utilisé avec discernement, il devient un outil de communication émotionnelle puissant.
Quand crier devient néfaste
Malheureusement, tous les cris ne sont pas bénéfiques. Crier de manière répétée sur son entourage – ses enfants, son partenaire, ses collègues – peut générer de l’insécurité, de la peur et de la méfiance. Chez l’enfant, en particulier, les cris constants sont associés à des troubles du comportement, du sommeil et à une faible estime de soi.
Il est aussi important de distinguer le cri libérateur du cri destructeur. Crier pour intimider, humilier ou contrôler ne libère pas les émotions : cela les détourne. À long terme, cela abîme les relations, mais aussi le bien-être intérieur.
Les cris thérapeutiques, un outil de libération
Certaines approches psychocorporelles utilisent le cri de manière encadrée. C’est le cas du yoga du cri, de la relaxation vocale, ou encore de l’expression primal scream. Ces techniques permettent d’évacuer des émotions enfouies – parfois depuis l’enfance – et d’apaiser des tensions psychiques ou physiques.
Lors de ces séances, on apprend à crier en pleine conscience, à écouter son corps, à exprimer ce qui ne pouvait pas l’être autrement. Cela se pratique souvent dans un cadre sécurisé, accompagné par un professionnel.
Ces formes de cri thérapeutique peuvent avoir des effets puissants : un soulagement émotionnel, un regain d’énergie, une meilleure conscience de soi.
Le cri et les émotions : un équilibre à trouver
Crier ne doit pas devenir une habitude automatique, mais une expression choisie. Il faut différencier le cri réflexe (lié à la douleur ou à la peur) du cri libérateur ou intentionnel. Le premier est instinctif, parfois traumatique, le second peut être transformateur.
Crier sous le coup de la colère, sans filtre ni recul, n’apporte pas toujours de soulagement. Cela peut même entretenir le conflit intérieur. À l’inverse, prendre le temps de comprendre son émotion, de respirer, et de choisir de crier pour lâcher prise… peut faire toute la différence.
De la même manière, il est important de respecter son entourage. Si un cri vous fait du bien mais blesse l’autre, le bénéfice est vite annulé. C’est pourquoi il est utile de trouver des espaces adaptés pour exprimer ce type de cri : dans la nature, dans un lieu isolé, ou lors d’une séance guidée.
Et dans la vie quotidienne ?
On peut tout à fait intégrer cette forme de libération vocale dans sa routine :
Crier dans sa voiture, en pleine campagne, ou dans un oreiller
Participer à un atelier de respiration ou de yoga vocal
Pratiquer la cohérence cardiaque et ponctuer l’exercice par un cri symbolique
Accompagner ses cris d’une visualisation : expulser le stress, la peur, une douleur
Ces petites routines, loin d’être farfelues, permettent souvent de se reconnecter à son corps, à sa voix, à son espace émotionnel.
Oui, crier peut faire du bien. C’est une manière instinctive et naturelle de libérer la pression, d’exprimer une émotion, de renforcer un lien ou de retrouver de l’énergie. Mais pour que ce soit bénéfique, il faut que le cri soit voulu, canalisé et respectueux, autant de soi-même que des autres.
Plutôt que de le subir ou de le réprimer, nous pouvons apprendre à utiliser le cri comme un outil de bien-être. En l’intégrant avec conscience dans notre quotidien, il devient une source de soulagement et d’équilibre.
Alors… et si crier devenait un geste de santé ?
Donnez-nous votre avis !
Envoyer mon avisMerci pour votre retour.